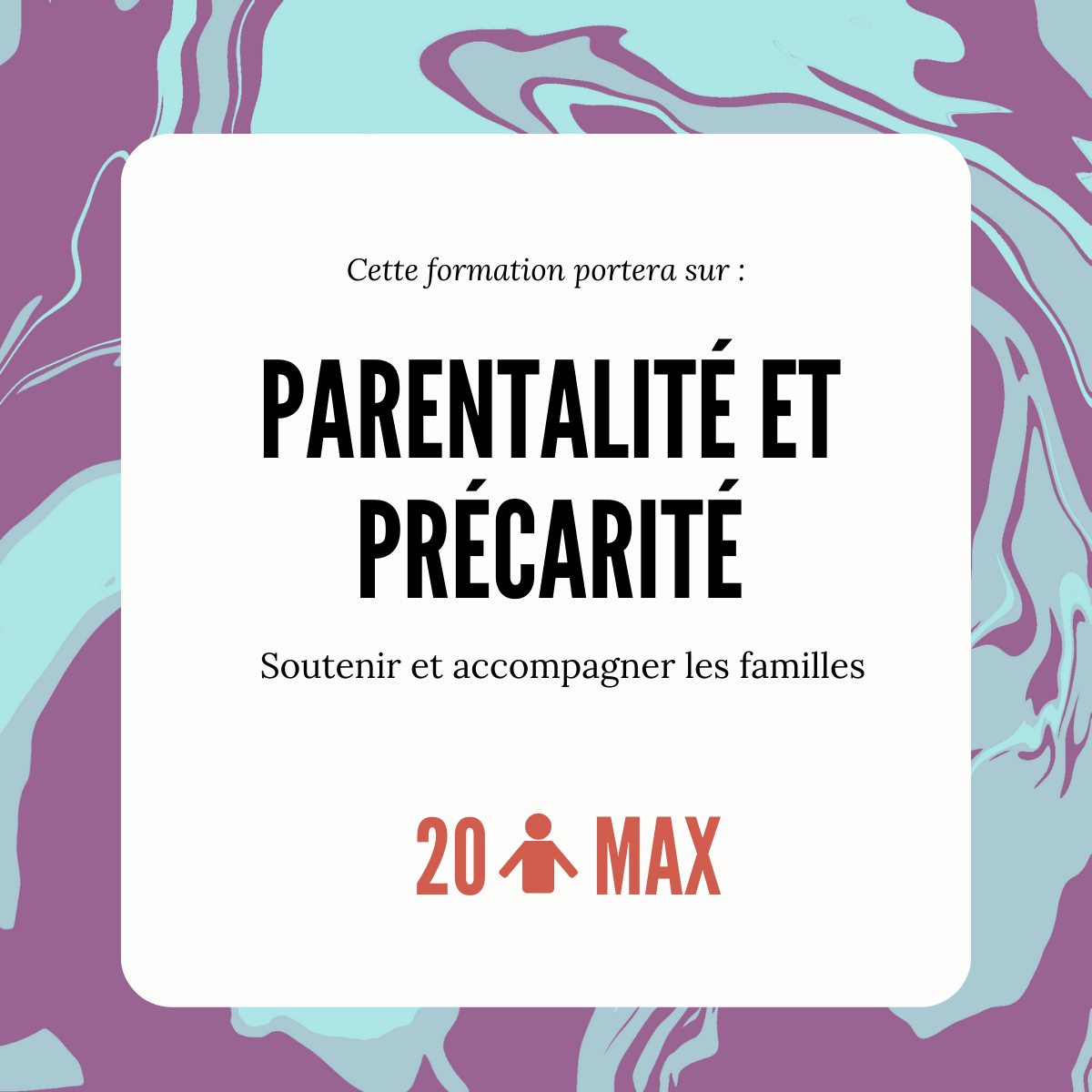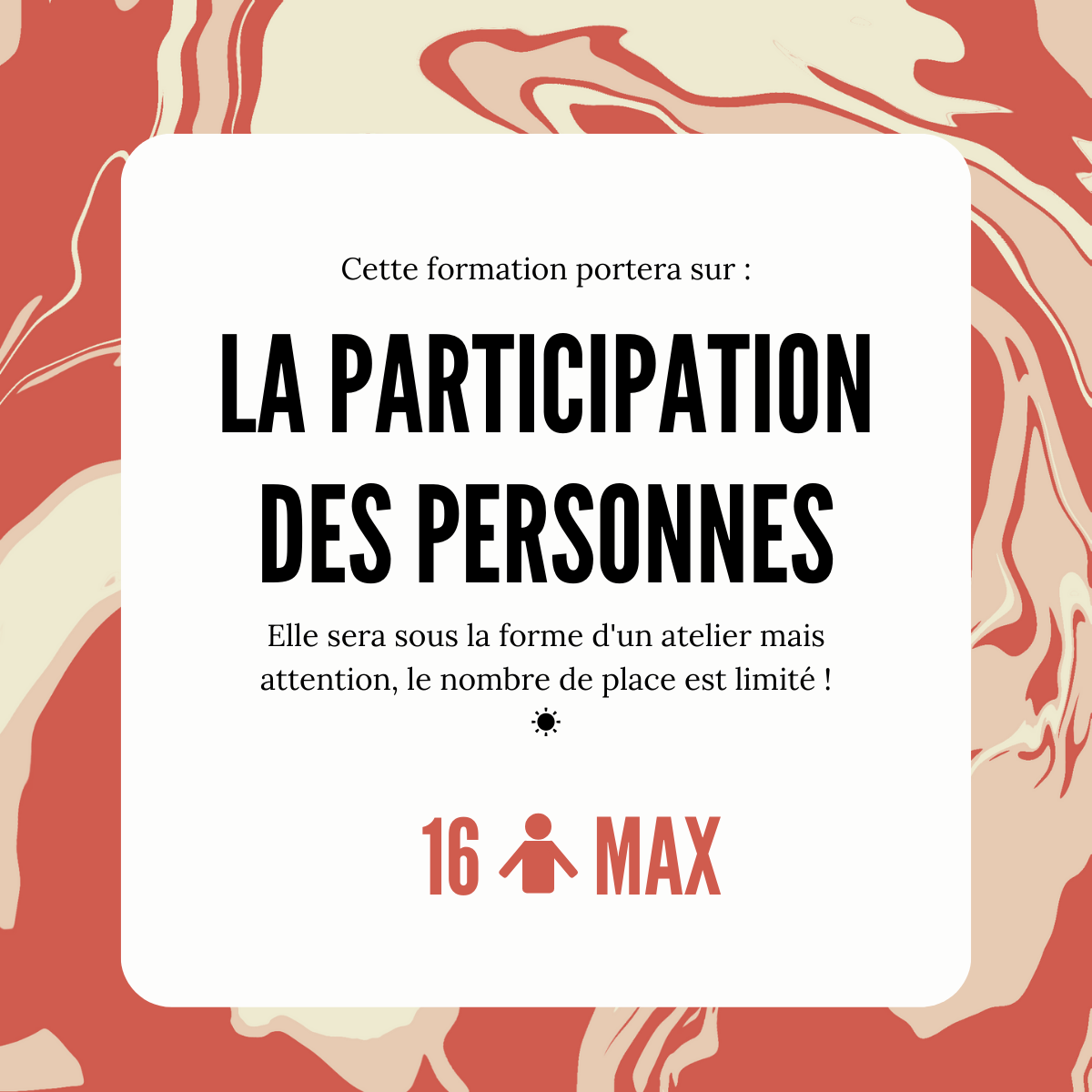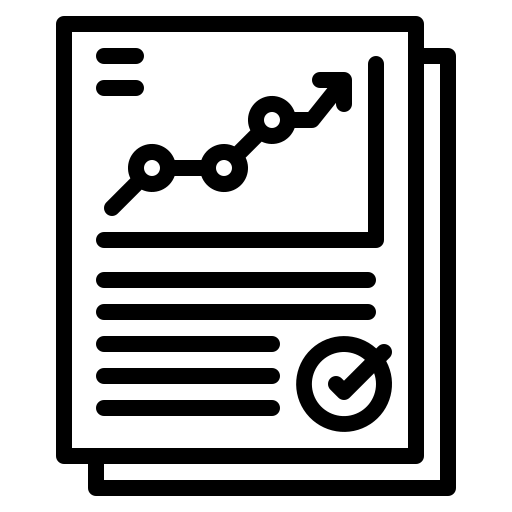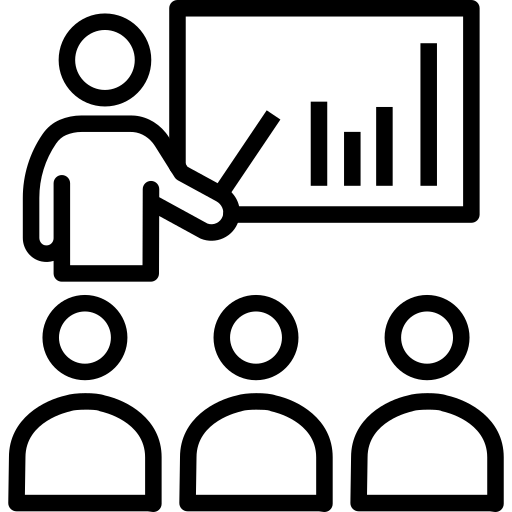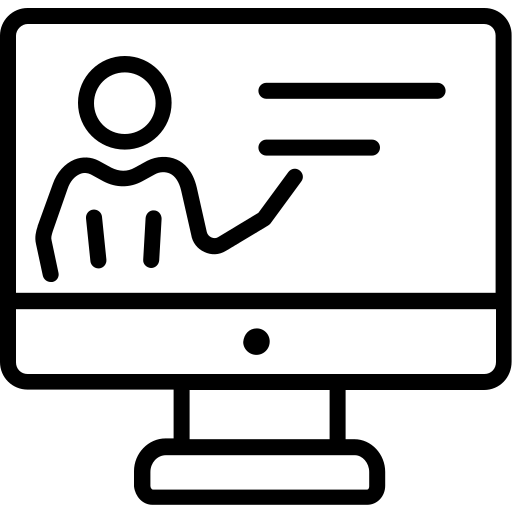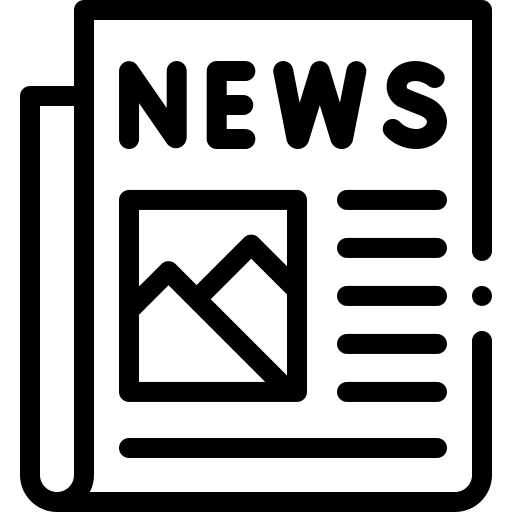Nous luttons contre l’exclusion en produisant, avec les personnes en situation de grande pauvreté, de la connaissance mobilisable et mobilisatrice pour agir.

MAIS C'EST QUOI LA MRIE ?
La MRIE, c’est une équipe engagée dans la lutte contre l’exclusion, produisant sur mesure des connaissances, des outils, des repères mobilisables pour l’action.
La Mrie s’appuie sur ce que lui partagent et lui apprennent les personnes en situation de pauvreté/ de précarité. En ce sens, elle s’applique à mettre en œuvre un croisement des connaissances émanant de trois sources : des chercheur·ses, des professionnel·le·s de terrain, et des personnes vivant l’exclusion. Par ailleurs, la Mrie fait reposer ses travaux sur une rigueur méthodologique et sur la volonté qu’ils puissent être mis en dialogue et mobilisables pour l’action.
RETROUVEZ NOS TRAVAUX !
Parce que pour la MRIE, la diffusion de la connaissance est une valeur essentielle, nous mettons à disposition une grande majorité nos productions en ligne gratuitement.
Retrouvez tous nos rapports depuis 1993 jusqu’à aujourd’hui et apprenez-en plus sur la thématique de la grande pauvreté.
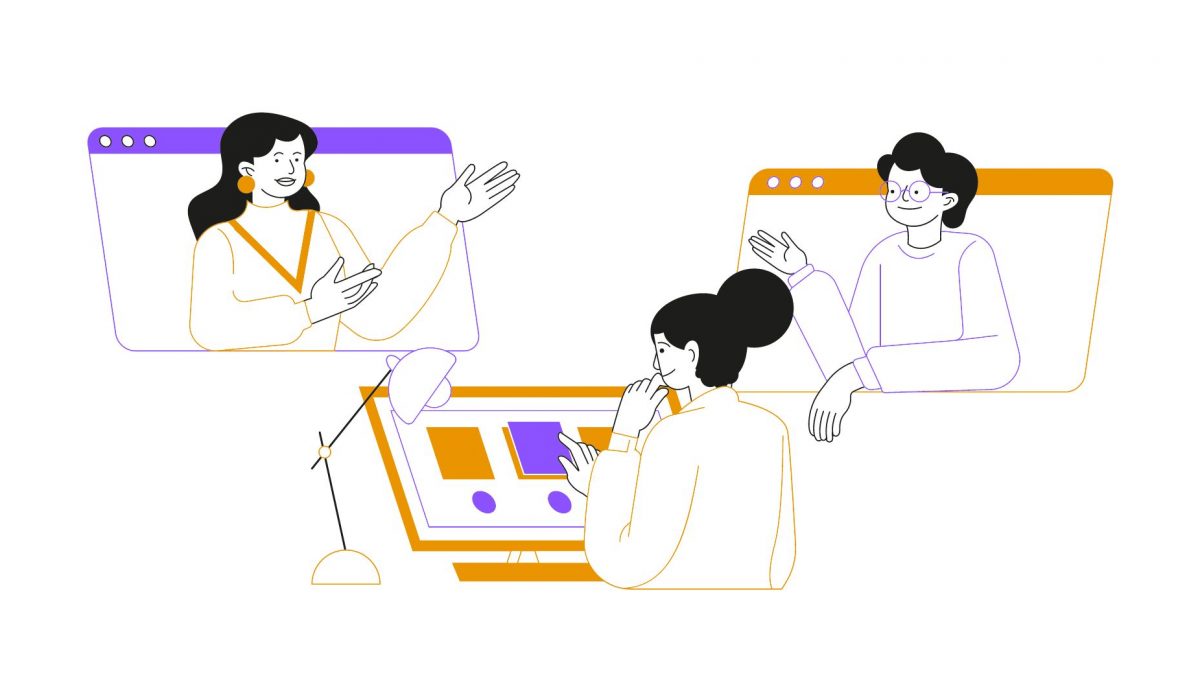
NOTRE ACTUALITÉ